La frontière de verre
La Frontière de verre est un roman de Carlos Fuentes paru en 1995. Sous-titré « roman en neufs récits », cette œuvre fait de l’éclatement narratif la métaphore éclairante d’un pays, le Mexique. En effet, il s’agit d’évoquer la tension de cette nation, entre unité et fragmentation, le prisme d’une identité culturelle et nationale morcelée.
Le titre évocateur de La Frontière de verre est calqué sur l’expression apparue dans les années 1970 et bien connue en sciences sociales, the glass ceiling, le plafond de verre, métaphore de l’impossibilité pour un employé d’accéder aux étages supérieurs de son entreprise et donc d’évoluer. Dans le roman de Carlos Fuentes, l’expression transformée désigne l’attraction exercée par les États-Unis sur les Mexicains qui observent, contemplent à travers la vitre (vitrine) de la frontière le rêve américain, et ainsi l’utopie de leurs propres existences. L’époque est d’ailleurs un moment charnière de l’histoire du Mexique, le second choc pétrolier de 1981, date à laquelle le pays a perdu l’illusion de devenir une grande puissance : encore un miroir-mirage brisé…
Dans le récit qui porte le titre du roman, Carlos Fuentes fait le portrait en miroir de deux individus, un laveur de carreaux mexicain, Lisandro et Audrey, une Américaine. Leur rencontre muette se fait de part et d’autre de la vitre d’un building décrit comme une illusion :
Dans ce labyrinthe miroitant, il est impossible de s’orienter : « Lisandro grimpait vers le ciel de verre, mais son impression était plutôt celle de se noyer, de sombrer, dans une étrange mer vitrée » . L’illusion est ainsi celle du partage et de la communion entre deux êtres : « Séparés des autres, elle et lui face à face par un samedi matin insolite, séparés par la frontière de verre »
Ainsi, cette réinvention de l’identité rend incertaine l’existence même du Mexique : dans l’avion qui l’amène aux États-Unis, Lisandro ne veut pas regarder
En bas de peur de découvrir une chose horrible qui ne se voyait peut-être pas que du ciel : il n’y avait plus de pays, plus de Mexique, le pays était une fiction ou plutôt, un rêve prolongé par une poignée de fous qui crurent un jour en l’existence du Mexique.
Les Mexicains, quant à eux, se perdent dans un autre labyrinthe, celui des vitrines et des galeries marchandes du Nord, comme le Mexicain que rencontre Dionisio, jouant aux mannequins de vitrines : « Je suis entré ici un jour et je me suis perdu dans le dédale des galeries, je ne suis plus jamais ressorti ». Le critique culinaire tombe en arrêt devant la vitrine lors d’une scène cocasse :
Il arrêta sa course devant une vitrine de l’American Express. Il y avait un mannequin représentant un Mexicain typique en train de faire la sieste appuyé contre un nopal, vêtu en péon, avec un grand sombrero et des sandales. Le côté cliché de la représentation indigna Dionisio qui fit irruption dans l’agence de voyages, secoua le mannequin, mais le mannequin n’était pas en bois mais en chair et en os.
(…...........................................................................)
Et Dionisio dit à son compagnon, dépouille-toi de tout, débarrasse-toi de tes vêtements, comme je le fais, jette tout dans le désert, nous rentrons au Mexique, sans rien de gringo sur nous, rien, mon frère, mon semblable, nous rentrons nus dans notre patrie, regarde, on aperçoit la frontière, ouvre bien les yeux, tu vois ? Tu sens ? Tu savoures ?
On voit ici une fois de plus combien l’identité mexicaine se fonde sur l’oubli et la perte : il faut se débarrasser de l’identité étatsunienne, l’oublier. Le Mexicain remplit le vide du désert pour entrer dans son pays d’origine, « sans rien de yankee »
d'après
Geneviève
Dragon
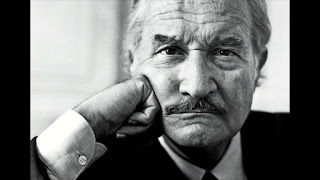



Commentaires
Enregistrer un commentaire